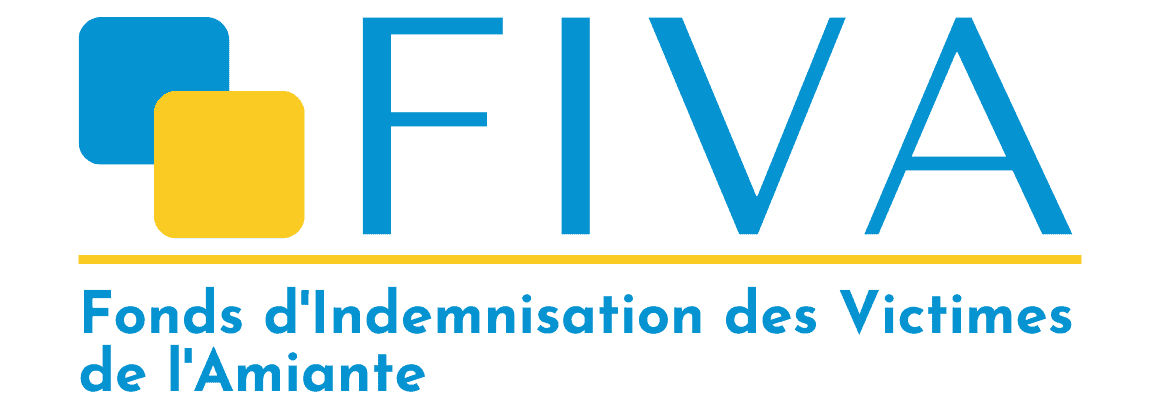Les évolutions juridiques
L’histoire du 20e siècle est marquée par l’impact économique et sanitaire de l’utilisation de l’amiante.
En même temps que se développait l’utilisation massive du «magic mineral», en raison notamment de sa forte résistance au feu, de sa faible conductivité thermique et de son faible coût, les premiers rapports sur la situation sanitaire des personnes exposées à l’amiante en révélaient la dangerosité. C’est le début des évolutions juridiques concernant l’amiante.
Ainsi, en France, le rapport de l’inspection du travail rédigé par Denis Auribault, publié en 1906, relevait qu’il avait observé en 1890, qu’au sein d’une usine de filature et de tissage d’amiante à Condé-sur-Noireau, l’absence de ventilation assurant l’évacuation des poussières d’amiante avait occasionné de nombreux décès dans le personnel.
La loi du 12 juin 1893, complétée par le décret du 10 mars 1894, inaugurant la réglementation sur l’hygiène et la sécurité, est la première à se pencher sur la question des poussières industrielles :
«Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques, seront évacués directement au dehors de l’atelier, au fur et à mesure de leur production… l’air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l’état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.»
La conscience du danger des fibres d’amiante fut réglementairement mise en évidence par l’inscription en 1945 d’une première pathologie liée à l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles reconnues par le régime général de la sécurité sociale, consacré à la silice.
Ce n’est toutefois que par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 que les maladies consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante ont été insérées dans un tableau distinct, le tableau n° 30. Puis, par décret numéro 96-445 du 22 mai 1996, a été créé le tableau n° 30 bis concernant le cancer broncho-pulmonaire primitif. Enfin, ces tableaux ont été transposés au régime agricole par la création des tableaux 47 et 47 bis.
Les tableaux des maladies professionnelles (régime général) :
Retrouvez l'ensemble de notre documentation FIVA via le lien ci dessous.
Pour autant, bien qu’alertées des dangers pour la santé de l’exposition aux poussières d’amiante, les industries transformatrices ou utilisatrices d’amiante, tout comme les pouvoirs publics, ne prendront pas toujours les mesures nécessaires.
La limitation du recours à l’amiante par les pouvoirs publics interviendra avec la publication du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante suite au classement comme cancérogène de toutes les variétés d’amiante par le CIRC.
Ce n’est que 20 ans plus tard, après une forte médiatisation du risque sanitaire et notamment la publication du rapport INSERM intitulé «les effets sur la santé des principaux types d’expositions à l’amiante» que l’usage de l’amiante sera interdit en France par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996.
La mise en place de dispositifs spécifiques d’indemnisation des victimes de l’amiante est une préoccupation née au milieu des années 1990, à mesure de la généralisation de la prise de conscience du risque liée notamment à la multiplication des pathologies directement imputables à une exposition à ces fibres.
Ainsi, par l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a été créé le Fonds de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (FCAATA), qui finance l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). A condition d’être âgées d’au moins 50 ans, cette allocation bénéficie aux victimes reconnues atteintes d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante au titre du régime général ainsi qu’aux salariés ou anciens salariés d’établissements utilisant de l’amiante ou ayant été mis en contact avec de l’amiante, dont la liste est fixée par arrêté.
Le 30 mai 2000, le tribunal administratif de Marseille juge l’État «responsable des conséquences dommageables du décès» de quatre personnes contaminées. C’est la première fois que l’État est directement mis en cause. Par quatre décisions du 3 mars 2004. Le Conseil d’État confirmera la responsabilité de l’État et le condamnera à indemniser les victimes de l’amiante sur le fondement de la faute pour carence de l’action de l’État dans le domaine de la prévention des risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante.
C’est dans ce contexte que l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a posé le principe de l’indemnisation intégrale des préjudices subis par l’ensemble des victimes de l’amiante et leurs ayants droit et a créé le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA).
Le décret d’application n° 2001-963 du 23 octobre 2001 organise le fonctionnement de l’établissement.
Enfin, un arrêté du 5 mai 2002 fixe la liste des pathologies dites «spécifiques» de l’amiante dont le seul constat vaut justification de l’exposition et ouvre droit à indemnisation :
- 1. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ;
- 2. Plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Ainsi, jusqu’alors indemnisées par les Commissions d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) , qui permettent d’indemniser toute personne victime d’une infraction pénale, même si l’auteur de celle-ci n’est ni identifié ni condamné, les victimes de l’amiante voient la réparation de leurs préjudices confiée à la Solidarité nationale.
En parallèle, les victimes atteintes d’une maladie reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels ont la possibilité d’obtenir la réparation de leurs préjudices au titre de la faute inexcusable de l’employeur (article L 452-1 du code de la sécurité sociale), définie comme suit : En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver
S’agissant de l’action pénale, si un employeur peut être condamné pénalement pour délit de mise en danger de la vie d’autrui pour avoir exposé ses salariés à des poussières d’amiante, sans avoir mis en œuvre les moyens de protection nécessaires, dans la mesure où le risque était certain, les mises en examen pour homicides et blessures involontaires, notamment de responsables politiques au plan national, n’ont à ce jour pas abouti.